Après quatre ans au pouvoir, l’heure est au bilan du mandat de Bruno Marchand. Pour plusieurs experts et organismes, il se caractérise surtout par l’importance accordée à la mobilité active, avec des politiques et des aménagements qui ont multiplié les options offertes aux cyclistes et aux piétons et redéfini la place de ces modes de transport à Québec.
Par Alexandre Morin
Depuis l’arrivée de Bruno Marchand à la tête de la Ville, la mobilité active est sur toutes les lèvres à Québec. Politique idéologique et preuve d’une guerre à l’auto pour les uns; symbole de modernité et d’ouverture aux autres moyens de transport pour les autres, elle s’impose comme l’un des enjeux marquants de son administration.
Un changement de culture
À la base, au-delà des aménagements concrets visibles, ce sont surtout les plans et la vision mis en place qui sont pointés comme un changement marquant. Un changement de culture qui s’est ensuite reflété dans les rues de la ville.
« La Ville de Québec a fait un effort de se doter d’une nouvelle politique de mobilité active puis on en voit les effets », explique Dominic Villeneuve, professeur agrégé en transport et mobilité à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD) de l’Université Laval.
Le professeur souligne que la nomination de Pierre-Luc Lachance au comité exécutif, responsable du transport, ainsi que celle de Maude Mercier Larouche à la tête du RTC, a entraîné un changement de culture. Comme ils ne possèdent pas de voiture, ils seraient plus sensibles aux enjeux liés au transport en commun et à la mobilité active.
« [Pierre-Luc Lachance] ne possède pas d’auto, il se déplace en vélo et en transport en commun, le chef des transports de la Ville de Québec ne possède pas d’auto […] la présidente régionale du RTC, Maude Mercier Larouche, aussi ne possède pas de voiture, ça c’est un changement de paradigme ! C’est pas le maire Labeaume qui faisait ça, on se rappelle le maire Labeaume disait que personne ne rêve de prendre l’autobus », indique-t-il, soulignant que le fait d’être eux-mêmes usagers rend les dirigeants de l’équipe Marchand plus conscients et plus déterminés à promouvoir la mobilité active, ce qui s’est reflété dans les politiques.
« Ce sont des usagers de mobilité active et ils ont fait beaucoup d’amélioration au réseau », résume-t-il.

ÀVélo change la donne à Québec
Le déploiement massif et l’extension du service de vélo-partage àVélo est aussi perçu comme un legs important de l’administration Marchand en matière de mobilité active.
« Tout le monde était contre, tout le monde disait que ça n’allait jamais marcher, pas de financement public pour le faire, c’est la Ville qui s’est organisée pour organiser ça et on connaît le succès inespéré d’àVélo », rappelle M. Villeneuve soulignant que, bien qu’àVélo ait été mis en place sous l’administration Labeaume, c’est l’équipe Marchand qui a assuré son expansion et son développement, notamment en augmentant le nombre de vélos, de stations et en prolongeant la saison.

Christian Savard, directeur général de l’organisme Vivre en Ville, abonde dans le même sens. ÀVélo a désormais une place bien établie dans le paysage de Québec. Son succès est indéniable et constitue une politique phare de l’administration Marchand.
« En termes de mobilité active, àVélo est un grand hit, ils ont [l’administration Marchand] appuyé sur l’accélérateur avec ça et ça fonctionne », explique-t-il.
Rappelons qu’àVélo a vu son nombre d’abonnés grimper à 35 113 en 2024, avec une hausse moyenne annuelle de 91 % d’abonnés depuis son lancement.
Le service compte aujourd’hui 1 800 vélos électriques répartis dans 165 stations à travers six arrondissements, en plus d’une saison prolongée jusqu’au 15 novembre. La Ville vise à porter la flotte à 3 300 vélos et 330 stations d’ici 2028, confirmant ainsi son ambition de renforcer la mobilité active dans tous les quartiers.
« À 35 000 abonnés, on n’est plus dans l’anecdote […] je pense que ça, ça marque vraiment en matière de mobilité active le mandat. Ils auraient pu y aller plus doucement, plus tranquillement. Non, ils ont appuyé sur l’accélérateur avec des résultats, le système tient le coup, ça fonctionne, c’est un bon succès », se réjouit M. Savard, ajoutant que le service s’est montré particulièrement utile pendant la grève des employés de maintenance du RTC lors de la dernière édition de Festival d’été de Québec.
« ÀVélo va faire maintenant partie de l’ADN de la Ville de Québec. »
Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville
Angèle Pineault-Lemieux, porte-parole d’Accès transport viable, met aussi de l’avant la démocratisation du cyclisme rendue possible grâce au service àVélo. Selon elle, l’assistance électrique permet à des usagers en moins bonne forme physique ou moins habitués au vélo de l’adopter malgré les côtes de Québec.
Elle note que le profil des utilisateurs s’élargit. « Ce n’est plus juste des jeunes hommes, jeunes femmes bien en forme en lycra, c’est cette idée que ça peut être les jeunes familles, les aînés, notamment grâce à la démocratisation de l’assistance électrique », explique-t-elle, ajoutant que l’expansion du service va permettre d’offrir cela à une population plus large qu’uniquement celle des quartiers centraux.
« Je te donne un exemple : moi, avant, j’allais moins souvent au travail en vélo parce qu’il fallait que je monte une côte, donc prendre une douche en arrivant […] C’est pas tout le monde qui peut prendre ce temps-là, de prendre une douche en arrivant et gérer la logistique de la serviette et tout ça. Depuis qu’il y a àVélo, je me sauve de la douche et je me sauve un 10-15 minutes en transport. Ça fait que j’ai tendance à l’utiliser plus souvent », témoigne-t-elle pour illustrer les avantages du service.
De la promenade au déplacement : le vélo devient utilitaire
Pour Pierre Baillargeon, président de la Table de concertation vélo des conseils de quartier, avant l’arrivée au pouvoir de Bruno Marchand, Québec misait surtout sur des pistes cyclables à vocation récréative, comme le corridor du Littoral et celui de la rivière Saint-Charles. Depuis, l’administration Marchand a donné une impulsion aux aménagements sécuritaires en milieu urbain, avec un virage clair vers les déplacements utilitaires, notamment grâce aux corridors VivaCité.
« Je trouve que c’est une belle réalisation, le fait d’avoir une planification qui me dit qu’au moins on va avoir un réseau, une structure qui nous permet de desservir tous les quartiers et qui est 4 saisons », exprime-t-il, ajoutant que pour encore plus de sécurité, la Ville devrait aller davantage vers des installations permanentes.
« Plus il y a de séparation entre les automobiles et les cyclistes et piétons, mieux c’est. »
Pierre Baillargeon, président de la Table de concertation vélo des conseils de quartier
Pour lui, ces aménagements s’inscrivent dans une planification cohérente et un changement de vision, notamment avec l’adoption de la politique de mobilité active 2023-2027.
« C’est un plan beaucoup plus complet que les plans précédents », explique-t-il. « La grande marque de l’administration actuelle, ça a été d’insuffler cet aspect scientifique des bonnes pratiques internationales, un plan concret, puis le déploiement est en train de se faire, mais à mon avis, on est encore au tout début », ajoute-t-il.
Il souligne aussi l’intégration du vélo dans d’autres politiques, notamment celle sur la sécurité routière. « C’est l’intégration du cyclisme dans tous les documents de planification de la Ville, ce qui est un élément très important si on veut aller quelque part », résume-t-il.
M. Baillargeon parle d’une réelle accélération des infrastructures et des politiques en faveur du cyclisme depuis l’arrivée de Bruno Marchand à la mairie. Il note également l’augmentation des budgets consacrés aux structures cyclables, notamment dans le Plan d’investissement en infrastructures (PII). Selon lui, bien qu’il y ait eu des politiques pour le vélo sous l’administration Labeaume, « c’était très tranquillement ».
À titre d’exemple, pour l’année 2025, la Ville prévoit consacrer 23,7 M$ à la Vision de la mobilité active dans le cadre de son programme d’infrastructures.
Concernant l’aspect scientifique de la vision de la Ville, le professeur Villeneuve rejoint les propos de M. Baillargeon.
« J’ai fait des entrevues avec des fonctionnaires pendant l’administration Labeaume […] et je peux vous dire que l’utilisation de données probantes, ce n’était pas une force de l’administration précédente, et j’ai l’impression que c’est peut-être une différence avec l’administration actuelle », explique celui qui a conduit plusieurs recherches en aménagement du territoire et en transport.
Les données issues du monde politique étaient ainsi davantage valorisées sous Labeaume, tandis qu’aujourd’hui, l’administration Marchand s’appuierait davantage sur des données scientifiques.
Les corridors VivaCité sont des axes cyclables sécuritaires aménagés par la Ville. On y retrouve du marquage au sol, des bollards, parfois des bordures en béton et des feux adaptés pour les cyclistes. Ils sont entretenus l’hiver et visent à créer un réseau utilisable à l’année dans tous les quartiers.
Angèle Pineault-Lemieux voit aussi le développement du réseau cyclable comme l’un des plus grands legs du mandat de Bruno Marchand.
« Je crois que le plus grand gain des quatre dernières années, c’est définitivement le réseau cyclable. Non seulement son développement, mais le sentiment de sécurité puis la motivation à prendre le vélo que ça apporte, autant chez les gens qui étaient déjà cyclistes que chez de nouvelles personnes qui l’adoptent », affirme-t-elle, citant la dernière Enquête origine-destination, qui montrait que le seul mode de transport à avoir connu une croissance dans la région de Québec était le vélo.
« Il faut dire qu’il y a quatre ans, on était une ville qui parlait surtout du cyclisme récréatif. Mais là, on parle de plus en plus d’un cyclisme utilitaire, c’est-à-dire que les gens ont des trajets linéaires, sécuritaires, bien protégés pour se rendre au travail, aux loisirs, à l’université, au cégep. On vient sécuriser les déplacements quotidiens, ce qui était un peu moins le cas avant », ajoute-t-elle.
Sécurité
Les corridors VivaCité, au-delà de leur rôle structurant pour le cyclisme, représentent une avancée majeure en matière de sécurité routière, selon Christian Savard.
« Je transporte mon garçon sur le chemin Sainte-Foy vers son école tous les matins [à pied] et j’apprécie la voie cyclable même si on ne l’utilise pas, je n’ai plus des autos à un pied de mon garçon, c’est la voie cyclable qui fait une zone tampon », témoigne-t-il. « L’arrivée de voies cyclables, en plus de sécuriser certains déplacements, contribue à apaiser les villes. »
Bien qu’il reconnaisse que les pistes cyclables doivent être bien intégrées dans les quartiers, notamment en tenant compte des besoins des commerçants, il estime que l’administration Marchand a bien fait les choses à ce chapitre.
Concernant le corridor VivaCité sur le chemin Sainte-Foy et le retrait de certains stationnements dans le quartier Saint-Sacrement, il affirme : « Il y a un paquet de stationnements accessibles dans les rues à côté ou même dans le stationnement de la Caisse populaire […] ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas de stationnement [à cause de la piste cyclable]. »
Piétons
La mobilité active ne se limite pas au cyclisme, elle inclut bien sûr aussi la marche. Comme souligné précédemment, les corridors VivaCité sont décrits comme des infrastructures qui ont contribué à apaiser la circulation et à renforcer la sécurité des piétons sur les axes où ils ont été implantés.
Mais plusieurs autres aménagements ont également vu le jour pour améliorer la sécurité des piétons.
« Sans que ça soit encore parfait […] ils [l’administration Marchand] ont quand même amélioré les phases pour piétons durant les dernières années, qui sont plus longues. Avant, des fois, c’était très court et des personnes âgées n’avaient pas le temps de traverser », explique M. Savard.
Il ajoute avoir remarqué une augmentation des traverses piétonnes et salue l’arrivée des zones sécurisées pour aînés annoncées récemment par la Ville, ainsi que le développement des rues partagées.
Sous le dernier mandat, Québec a aussi vu l’arrivée sur son territoire des premières traverses piétonnes automatisées, notamment à l’intersection de Marie-de-l’Incarnation et du boulevard Charest, une autre petite révolution en matière de mobilité active à Québec.

Accès transport viable souligne toutefois le manque de remontées mécaniques. Mis à part l’ascenseur du Faubourg, il reste difficile de se déplacer entre la basse-ville et la haute-ville, particulièrement pour les aînés et les personnes à mobilité réduite selon l’organisme.
En quatre ans, l’administration Marchand aura réussi à placer la mobilité active au cœur des priorités municipales. De l’idéation à la réalisation, les gestes posés ont redéfini l’aménagement urbain et la place accordée aux déplacements actifs. Pour plusieurs, c’est plus qu’un virage : c’est le début d’une transformation de fond qui pourrait marquer durablement l’histoire de la mobilité à Québec.
Pour suivre l’actualité de Québec, rejoignez ce groupe !

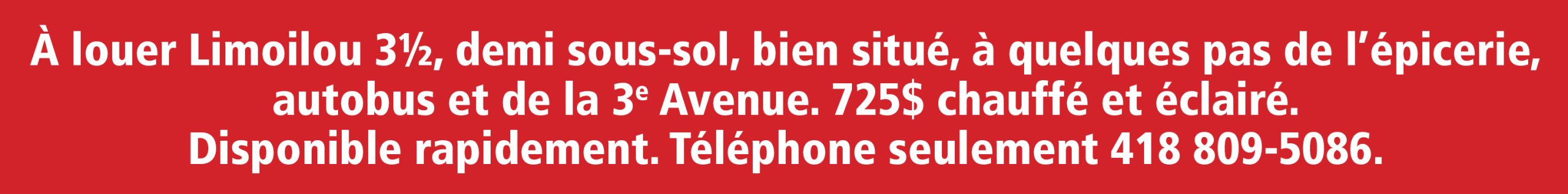

Un bilan se fait sur les objectifs annoncés en campagne. Pas ce qui n’était pas voulu. Il disait qu’il n’y aurait pas de tramway si les citoyens n’en voulaient pas. Il a promis 4 sondages par année qu’il a arrêtés, car désastreux, qu’il respecterait la capacité de payer quand le projet au complet était à 3,2 G$.Jamais il n’a parlé de guerre à l’auto et de surtaxation pour le transport en commun. Évaluation du bilan: 0/100
Le réseau cyclable utilitaire s’installe dans une ville déjà construite. Tout ne peut être parfait partout ! Si vous pensez à des améliorations possibles dans SJ Baptiste, parlez en au CQSJB. Puis, allez rouler un peu partout pour avoir une opinion plus générale svp.
Difficile de ne pas reconnaître le gros bon sens et la science derrière les choix de l’administration Marchand. En misant sur des données probantes et sur les meilleures pratiques internationales, Québec s’est dotée d’une vision cohérente et moderne de la mobilité active. On le voit : le succès d’àVélo, l’essor du vélo utilitaire et la sécurité accrue des piétons ne sont pas que des slogans, mais des résultats concrets adoptés par la population.
Reste que cette vision, aussi positive et saine soit-elle, demeure fragile dans un paysage politique où certains voudraient nous ramener aux histoires des années 70. Ne laissons pas l’oncle Sam et son beau-frère Stéphane-de-Lévis effacer les gains d’aujourd’hui
C’est une infopub cet article directement du 870 Salaberry! Pas sérieux. Placer le mot sécurité avec rue partagée et les àvelo?? Il n’y a jamais eu autant de risque s d’accident et de chicanes dans Saint-Jean-Baptiste. Mais bien sûr, on n’en dit rien, ça ne fait pas » positif » comme article. C’est juste la réalité que les citoyens concernés vivent.
Le réseau cyclable utilitaire s’installe dans une ville déjà construite. Tout ne peut être parfait partout ! Si vous pensez à des améliorations possibles dans SJ Baptiste, parlez en au CQSJB. Puis, allez rouler un peu partout pour avoir une opinion plus générale svp.